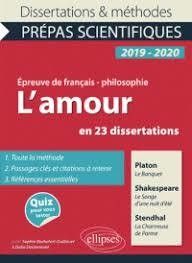aime aimer amis amour art article background belle bonne cadre centre chez
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Cours (9)
· Dissertation (20)
· Résumé (33)
· Comptes rendus (8)
· Fiction (3)
exposé sur le pouvoir de l'argent dans l'œuvre au bonheur des dames je veux qu'on m'aider svp
Par Anonyme, le 21.10.2021
lien entre amour et argent
Par Anonyme, le 03.06.2021
expose sur l argent dans au bonheur des dames
Par Anonyme, le 06.01.2021
précisé comment règne l'argent dans au bonheur des dames
Par Anonyme, le 10.12.2020
l'argent fait il le bonheur
Par Anonyme, le 22.11.2020
· L'argent: cours d'introduction
· la parole et la pensée
· Pouvoir de l'argent
· justice et société
· L'argent et le travail
· Les tragiques, d’Agrippa d’Aubigné
· Brève histoire philosophique du moi
· La justice/Dissertation
· La justice: la jurisprudence
· Le Mal, texte à résumer en 120 mots (+ ou -10%)
· Argent et liens sociaux
· Le mal, résumé du texte
· La Démocratie
· L'argent et la violence
· Avarice et prodigalité
Statistiques
Date de création : 05.05.2010
Dernière mise à jour :
27.07.2024
296 articles
Images
L'AMOUR
L’Amour
Sujet.
« Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. »
Vous vous interrogez sur la validité de cette assertion de Sigmund Freud, extraite de son livre Malaise dans la civilisation, à la lumière des œuvres inscrites dans votre programme.
Brahim Boumeshouli
Dissertation publiée dans l’ouvrage collectif, paru chez Ellipses, Paris, © été 2018. |
Remarques préliminaires
Le thème de cette année a un lien trop étroit avec celui de L’aventure.Jankélévitch consacre la troisième section du premier chapitre de son livre, L’aventure, l’ennui, le sérieux, à ‘’l’aventure amoureuse’’, qu’il qualifie d’« aventure par excellence », la vraie. Certains termes et couples d’opposés de Jankélévitch sont essentiels pour aborder le thème de l’amour : destin /destinée ; événement / avènement, etc.
Il serait toujours préférable d’aborder toute dissertation, à la lumière du précepte de Spinoza : « Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. »
Analyse du sujet
- « Nous ne sommes jamais » L’état de la souffrance est universel. L’emploi du présent montre le caractère permanent du constat.
- L’emploi du verbe ’’protéger’’ suggère que l’homme est naturellement doté de mécanismes contre la souffrance, affaiblis ou anéantis « lorsque nous aimons ». Comment ?
- Le propos de Freud doit inciter à redéfinir la souffrance, relative à l’amour, et voir en quoi elle serait différente.
Les enjeux du sujet
L’hypothèse freudienne est l’occasion pour cerner le sujet à partir de plusieurs prises de vues. Il est donc vivement recommander de ne pas rester au seuil de la citation et repérer toutes les directions vers lesquelles elle louche.
Rester dans le constat de la douleur « lorsque nous aimons », c’est raisonner à coup de clichés et, dans les meilleurs des cas, user des images romantiques.
Problématiser ne signifie pas, ici, une antithèse passe-partout, comme « Se libérer de la souffrance, en reniant l’amour» ! L’intérêt est de montrer comment une telle libération est possible, dans et par l’amour.
Problématique
L’amour n’est-il pas alors une possibilité inespérée pour passer outre la catégorie de la souffrance ?
Plan
L’amour, lieu de la souffrance
|
I.1. Le manque
I.2 L’extérieur
II. Mais, il libère
II.1De la vie insipide
II.2 De toute forme d’autorité
III. Un amour au-delà de toute souffrance
III.1 Une éthique de l’amour
III.2.Endurance physique et héroïsme
Introduction
C’est un lieu commun que de lier amour et souffrance. L’histoire elle-même est peuplée d’êtres ayant beaucoup soufferts, pour la simple raison qu’ils ont aimé. Les récits et films les plus appréciés sont les histoires d’amours qui se terminent par la noyade, le suicide ou encore l’entrée dans le couvent. La douleur touche aussi l’intérieur du sujet amoureux. Conformément à cette appréciation universelle, Sigmund Freud écrit, dansMalaise dans la civilisation : « Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. » L’état de la souffrance, coïncidant avec l’amour, est universellement expérimenté, dans la permanence « Nous ne sommes ». Il semble que le sujet est naturellement doté de mécanismes, qui le protègent contre la souffrance, et c’est l’amour qui l’en dépouille. L’attachement excessif, et parfois maladif, à un autre être, peut effectivement créer un déficit narcissique qui expose continument l’amoureux à toutes les formes de la douleur. Mais, un tel attachement se révèle également une formidable opportunité, pour ressentir et vivre autrement. Un autre mode du vécu, alors inconnu aux autres, s’offre à l’amoureux. L’amour n’est-il pas alors une possibilité inespérée pour passer outre la catégorie de la souffrance ? La lecture duBanquet de Platon,Songe d’une nuit d’été, de Shakespeare,La Chartreuse de Parme de Stendhal, nous permettra d’abord de repérer les éléments de la souffrance en amour ; avant de considérer l’amour comme une possibilité qui libère des facteurs, responsables de la douleur ; Ce qui présentera l’amour, enfin, comme la voie menant à un au-delà de la souffrance.
L’amour, lieu de la souffrance
C’est un lieu commun que de concevoir l’amour comme lieu de la souffrance, qui se manifeste d’abord comme manque, puis comme agression venue de l’extérieur.
I.1. Le manque
Être amoureux ou tout simplement en quête d’amour, c’est se soumettre à l’expérience de l’insuffisance, l’insatisfaction et l’absence de plénitude, alors que l’amour est censé les procurer d’entrée de jeu. C’est que ‘’Amour’’, pour l’étrangère Diotime, dans Le Banquet de Platon, est à l’origine « fils d’Expédient et de Pauvreté ». Et Socrate de gloser, en fin interprète, qu’aimer, c’est toujours désirer quelque chose, ce qui fonde l’amour sur la situation du manque, jamais comblé. Considérer ce constat comme vraisemblable, ou, ce qui est pire, prétendre le contraire, c’est récuser la nécessité, une modalité fondamentale dans l’argumentation : « Examine donc, reprit Socrate, si au lieu d’une vraisemblance, il ne s’agit pas d’une nécessité : il y a désir de ce qui manque, et il n’y a pas désir de ce qui ne manque pas ? ». Il en ressort que l’amour est une tension vers l’avenir, non une plénitude dans le présent. Avoir l’objet d’amour ici et maintenant, ou désirer l’avoir, revient au même : « Ce que j’ai à présent, je souhaite l’avoir aussi dans l’avenir (…) aimer ce dont on n’est pas encore pourvu et qu’on ne possède pas, n’est-ce pas souhaiter que, dans l’avenir, ces chose-là nous soient conservées et nous restent présentes ? » L’objet de l’amour, étant le beau lié intrinsèquement au bien, il va sans dire qu’aimer, c’est souffrir d’un manque de beau et de bien. DansSonge d’une nuit d’été de Shakespeare, cette illusion de l’amour, pris dans les rets du temps, qui coule ou qui n’advient pas, s’exprime dans toute la modestie du sujet lamentable, en posture d’amoureux. Lysandre : « Rapide comme une ombre, aussi court qu’un rêve / aussi bref qu’un éclair dans la nuit ténébreuse. » Il s’ensuit le constat terrible, à propos des peines réservées universellement, ad aeternam, à tous les amoureux : « Hélas ! pourquoi faut-il, dans tout ce que j’ai lu, ou ce que j’entendis de contes ou d’histoires, qu’un véritable amour n’ait jamais court facile ? » L’amour se définit de scène en scène comme peine,folie,ou encore aveuglement : « Tels objets bas et vils, réelles nullités, / l’amour peut leur donner formes et dignités. » Et c’est l’être amoureux qui en est responsable, en fin de compte : « Et cet esprit d’amour manque de jugement ». Toutes ces carences relatives à l’amour, et bien d’autres, sont relatées, et parfois mises en scène, dansLa Chartreuse de Parme, de Stendhal. L’être beau et agréable qu’est Fabrice Del Dongo, n’est pas mieux loti dans ce chapitre que les étourdis de la folle nuit. Il se trompe de jugement, lorsqu’il identifie l’amour à la beauté physique et il en souffre trop, faute de possession pleine et durable. Ses liaisons, trop nombreuses, n’ont pas pu assouvir sa soif d’aimer bien comme il faut : « N’est pas chose plaisante (…) que je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu’ils appellent de l’amour ? »
I.2 L’extérieur
La souffrance signifie également s’exposer aux différentes agressions provenant de l’extérieur. Dès qu’on devient amoureux, on est instantanément sujet à toutes les frappes, exécutées par une panoplie de forces, comprenant, selon Lysandre et Hermia, la condition sociale : « Malheur, qu’un sang trop haut soumis à sang trop bas ! » ; l’âge : « Ô, rage que plus vieux à plus jeune engagé ! » ; le choix imposé par les proches : « Enfer, qu’un choix d’amour fait par les yeux d’un autre ! » Et le pire est d’aimer librement et sincèrement, car c’est la Nature qui se donne le plaisir de persécuter les amoureux : « quand la sympathie fut le guide du choix, guerre, mort, maladie viennent pour l’assiéger, le rendant passager.» Si les attaques contre les amoureux sont ponctuelles et inévitables, c’est qu’elles sont une fatalité : « C’est l’effet d’un décret fixé par le destin.» Pour le cas de Lysandre et Hermia, l’extérieur à un nom : le père Égée, soutenu au début par Thésée, duc d’Athènes : « Ce sera ou bien d’épouser ce gentilhomme (Démétrius) / ou de mourir ainsi que le veut notre loi.» L’amour est aussi l’occasion des querelles des rivaux : Lysandre vs Démétrius ; Hélène vs Hermia ; et il fallait de peu pour en venir aux mains. C’est que ‘’Amour ’’ est toujours « pauvre et il s’en faut de beaucoup qu’il soit délicat et beau. » Lit-on dans Le Banquet. Pour Diotime, L’Amour ne vit que pour réussir « ses expédients » sinon, « il est mourant ». Or, pour revenir à la vie « il ne cesse de tramer des ruses ». Aimer, n’est-ce pas donc subir les ruses, fomentées par Amour, qui est « rude, malpropre, va-nu-pieds. » ? L’une des victimes de cette nature immonde est l’objet aimé, pris d’abord comme « beau corps » digne « de beaux discours », avant de devenir objet de mépris, rejeté et décrié par l’amant « son impérieux amour pour un seul se relâchera ; il le dédaignera et le tiendra pour peu de chose. » C’est pourquoi Socrate refuse obstinément d’inscrire son amour pour Alcibiade dans l’ordre du physique - malgré les avances incessantes de ce dernier- pour lui épargner les douleurs ultérieures de la séparation, conséquence immanquable de la possession physique : « il dédaigna ma beauté, il sen moqua et se montra insolent à son égard. » confie Alcibiade aux banqueteurs. Et si ce mal-aimé souffre temporairement de ce dédain, il gagne en revanche une paix durable : « Par suite, il n’y avait pour moi moyen ni de me fâcher et de me priver de sa fréquentation, ni de découvrir par quelles voies je l’amènerais à mes fins.» DansLa Chartreuse de Parme, amoureux réellement ou non, heureux vraiment ou non, Fabrice est l’objet d’attaques extérieures incessantes, du moment où il est perçu, eu égard à sa beauté, comme rival invincible. Ce programme narratif est prophétisé par l’abbé Blanès : « Ta vie sera très heureuse aux yeux des hommes.» Le comte Mosca, par exemple, « regarda Fabrice », et estimant n’avoir aucune chance de lui disputer Gina: « une idée atroce [le] saisit comme une crampe : le poignarder là devant elle, et me tuer après ? » Pour le Comte, comme pour les autres, Fabrice est un rival de taille, qu’il faut battre : « Grand Dieu ! Comment combattre un tel ennemi ? ». Et ce n’est pas Gilleti qui s’angoissera autrement !
Si l’amour affaiblit le sujet et le rend vulnérable face à la souffrance, il n’en demeure pas moins qu’il est aussi une aubaine, qui le délivre de la quotidienneté insipide et prosaïque ; et l’incite à renier cette vulnérabilité, en affrontant toute forme d’autorité.
II. Mais, il libère
II.1 De la vie insipide
L’amour brise tout lien avec la monotonie de la vie, et offre aux amoureux la possibilité d’évoluer dans un monde, saisi non par l’événement, mais l’avènement, pour retenir les termes de Jankélévitch. Phèdre, dans Le Banquet, oppose nettement à la vie normale, une vie de qualité : « vivre comme il faut ». Or, cette dernière n’est accessible que par une voie unique, celle de « l’amour ». Car, ni « les relations de famille, ni les honneurs, ni la richesse, ni rien d’autre qui les produise » ne sont en mesure d’assurer une telle vie. L’amoureux cherche à plaire à l’amant, c’est pourquoi, il s’interdit « l’action laide » et n’accomplit que « l’action belle ». Le monde des amoureux est le lieu où s’opère un rééchelonnement des rapports humains. En effet, l’amoureux peut supporter d’être méprisé par « son père, ses amis ou quelqu’un d’autre, que par son amant. » Ce motif est loin d’être minime, puisqu’il est le moteur des grandes réalisations, qui délaissent les sentiers battus de la vie sans qualité, pour la réalisation des miracles, et Phèdre d’ajouter, quelques siècles avant Hegel : « Sans cela, en effet, ni cité ni individu ne peuvent réaliser de grandes et belles choses», avant d’orner son encomiastique par un admirable exemplum : « si des hommes comme ceux-là combattaient coude à coude, si peu nombreux fussent-ils, ils pourraient vaincre l’humanité en son entiers pour ainsi dire. » Si la vie normale est soumise au destin, c’est-à-dire la mort après une vie installée, la vie que propose l’amour est saisie par la destinée, c’est-à-dire forger son propre aura, à l’exemple d’Achille : « prévenu par sa mère qu’il trouverait la mort s’il tuait Hector, tandis que, s’il ne le tuait pas, il reviendrait au pays et finirait ses jours âgé, il eut l’audace de faire quelque chose pour Patrocle, son amant et de le venger. » C’est à ce type de vie que se préparent Hermia et Lysandre, après avoir constaté la singularité de l’amour : « Prenons donc patience au sein de notre épreuve, / Puisqu’elle est pour l’amour entrave habituelle.» Que faire ? Fuir, c’est-à-dire s’aventurer, à la recherche des lieux compatibles à l’amour « Là-bas, charmante Hermia, je pourrai t’épouser, / Car en cet endroit-là la dure loi d’Athènes est sans pouvoir. » Fidèle aux enseignements de Phèdre, Lysandre invite son amante à le préférer aux siens et à briser tout lien avec les repères de la vie normale : « si tu m’aime, quitte demain, de nuit, la maison paternelle. » Cette fuite plongera les amoureux, parfois à leur insu, dans un cycle d’enchantement et d’émerveillement, impossible ailleurs : fées ; inconstance par ensorcellement ; dangers de mort, etc. La fougue shakespearienne n’épargne aucune catégorie de l’être de l’impact de cette qualité de vie. Le duc d’Athènes, Thésée, veut l’universaliser, tant il est radicalement différent : « Philostrate, va-t’en dans Athènes, exciter la jeunesse à la joie / Réveiller l’esprit leste et vif de la gaité, / Que la mélancolie se consacre aux obsèques. » Est-il nécessaire de parler aussi de Titania qui se prend de Bottom à tête d’âne ? DansLa Chartreuse de Parme, même s’il était encore persuadé que « la nature [l’a] privé de cette sorte de folie sublime», qu’est l’amour, Fabrice ne trouvait aucun autre moyen pour dissiper « tous les chagrins d’un courtisan », et de se débarrasser de « son costume officiel » que de séduire la pauvre Marietta Valserra ! Mais, amoureux de Clélia, qui un « air noble au milieu de ces êtres grossiers », il éprouve une nouvelle vie, radicalement différente, jusqu’à faire de la prison un lieu de délices : « N’est-il pas plaisant de voir que le bonheur m’attendait en prison ? ».
II.2 De toute forme d’autorité
L’amour, qui inaugure un autre mode de vie, inspire en même temps le désir de s’émanciper et de passer outre toutes les formes d’asservissement. Amour et contrainte ne cohabitent pas. Les tyrans ont en peur, et œuvrent pour l’étouffer, car il menace leur pouvoir, comme le note Pausanias, dansLe Banquet : « C’est que chez les barbares, l’exercice du pouvoir tyrannique conduit à faire de cela, en tout cas, quelque chose de honteux. » Si, pour le barbare, « la passion pour le savoir » est suspecte, car elle fait naître « chez leurs sujets de hautes pensées », le crime de l’amour est beaucoup plus insoutenable, puisqu’il réalise « de solides amitiés et de fortes solidarités.» Et ce n’est pas les tyrans grecs qui prétendraient le contraire, eux dont le pouvoir fut justement brisé par « l’amour d’Aristogiton et l’affection d’Harmodios. » DansLa Chartreuse de Parme, le défi de l’autorité du père ou du prince est dicté plutôt par le principe politique. Mais, là aussi l’amour est décisif. En fait, étant encore très jeune, voire mineure, lorsqu’il choisit le camp de Napoléon, au grand dam de son père et de l’autorité parmesane, Fabrice est plus mû par l’amour de Napoléon que par un choix véritablement réfléchi : « je vais rejoindre l’empereur. » Lorsque Fabrice enlève le comte Mˣˣˣ et se bat en duel avec lui, c’est pour se venger. C’est l’humanité féminine qui se montre plus disposée à défier les autorités, pour honorer l’amour. Pour sauver Fabrice, Gina se soulève contre toute la cour à Parme, et Clélia contre père et geôlier. DansSonge d’une nuit d’été, c’est, justement, Hermia qui défie le père qui, à l’instar de celui de Juliette, entend annuler totalement sa liberté : « comme elle m’appartient, je puis disposer d’elle. » Dans une admirable passe d’arme, Hermia révoque la logique du père et son fondement, à savoir « notre loi », selon l’expression d’Égée. Au vouloir contre-nature du père « ma fille est à moi », elle se contente d’opposer le bon sens : « Je voudrais que mon père y vit avec mes yeux. » Elle s’étonne de son propre courage, peu intelligible : « Je ne sais quel pouvoir me rend aussi hardie.» Hermia en a tellement besoin, face au pouvoir politique intransigeant, qui lui accorde le choix entre le mauvais et le pire : « Ou d’être mise à mort, ou sinon d’abjurer / pour toute votre vie la société des hommes.» Hermia maintient le défi jusqu’au bout, et comme pour célébrer définitivement son affranchissement, elle persiste et signe : « mourir, plutôt que faire don de ma virginité, / Monseigneur, à celui dont mon âme ne veut subir le joug odieux de souverain seigneur.» Le duc d’Athènes avait beau se prévaloir, au début, comme le fidèle dépositaire de « la loi d’Athènes » qu’il ne pouvait « atténuer en rien», mais il était aussitôt fléchi par l’amour, et rien d’autre, et le voilà qui reniait la même loi devant le pauvre père « Égée, je prévaudrai sur votre volonté : / dans le temple, sous peu, ces couples avec nous, / je veux qu’ils soient unis d’une chaîne éternelle. »
III. Un amour au-delà de toute souffrance
Si l’amour libère le sujet, en annulant les effets de la souffrance, c’est parce qu’il institue un mode de vie dont la qualité mène, in fine, à un horizon, où la souffrance ne prend plus. Ce qui est manifestement attesté premièrement par la célébration des principes, justifiant ensuite une pratique amoureuse, dont l’endurance physique, presque surhumaine, n’est pas la seule vertu.
III.1 Une éthique de l’amour
L’amour, contrairement à ce que pensent certains philosophes comme Kant, implique un agir non dénué de morale. Il est même indissociable d’une certaine éthique, trop exigeante pour le sujet. Dans Le Banquet, Agathon juge nécessaire de rappeler la vertu d’Éros, après avoir parlé de sa beauté : « C’est la vertu d’Éros qu’il faut ensuite évoquer.» Il liste alors trois vertus propre à l’Amour : ‘’ la justice’’ ; ‘’la modération’’ ; ‘’le courage’’. Les vertus d’Éros, en plus de sa ‘’science’’, permettent aux hommes de se rapprocher, car c’est lui « qui nous vide de la croyance que nous sommes des étrangers l’un pour l’autre.» Aimer, c’est être délicat et fin, car l’amour « apporte la douceur, alors qu’il écarte l’agressivité... généreux en bienveillance, avare en malveillance.» Pausanias, comme préparant l’apologie d’Agathon, incite ouvertement à observer une pratique vertueuse dans l’amour, pour mériter l’éloge et éviter le blâme : « La chose…est belle, si on se conduit comme il faut, et honteuse, si on se conduit de façon honteuse.» Il en découle une catégorie des amoureux ‘’vulgaires’’, dont la principale tare est d’aimer ‘’le corps’’, non ‘’l’âme’’. La beauté et la jeunesse étant éphémères, l’amant ne peut être qu’ ’’inconstant’’. D’où la nécessité d’établir une sorte de cursus, à même de perfectionner la pratique amoureuse. Premièrement, « soumettre les amants à une épreuve sérieuse et honnête», pour que l’amour soit méritoire et dissocié de tout intérêt politique ou financier ; deuxièmement, la relation entre les amants doit aspirer à tout « ce qui est compatible avec la justice ». DansSonge d’une nuit d’été, contrairement aux règles de la guerre, qui permettent de ravir sans coup férir, l’amour impose un autre mode d’action, basée justement sur la douceur. C’est ainsi que Thésée, le vainqueur d’Hippolyte, est contraint de faire profil bas, s’il veut la conquérir : « Hippolyte, je t’ai courtisée par l’épée…Mais je veux t’épouser sur un tout autre mode-/Dans les fêtes, la pompe et les réjouissances.» Conformément au principe d’un amour consenti, affirmant la liberté du choix, Hermia revendique de disposer elle-même de sa virginité. En fait, l’amour est plus précieux que naissance, richesse et donc il est incessible, comme le montre Lysandre, devant ses lyncheurs : « Enfin- ce qui est mieux que tous ces vains prestiges- / C’est moi qui suis aimé de la charmante Hermia.» Lysandre se présente comme l’amant modèle face au blâmable Démétrius : « Cet homme douteux aussi bien qu’inconstant.» Tout comme Hermia, il perçoit l’amour comme inaliénable : « Pourquoi devrais-je donc renoncer à mon droit ? » Dans le monde de la passion amoureuse l’agir et le dire sont sacrés, car ils sont jugés à l’aune d’une morale intransigeante. Hermia le sait bien, elle, qui jure par six symboles dans une seule réplique, afin d’assurer sa fuite avec Lysandre : « Je te le jure (…) et, sans faute, demain je t’y retrouverai. » Une morale si tenace, voire même retorse, qu’elle blâme, en oblique, et par anticipation, l’inconstance ultérieure de Lysandre : « je te le jure (…) par ce feu qui brûla la reine de Carthage, / Quand le Troyen perfide eut déployé ses voiles.» Dans l’œuvre de Stendhal, l’amour est tributaire de la guerre et de la politique. Les personnages ne se sont détournés vers l’amour que parce que leur idéal politique s’est effondré lamentablement à Waterloo. C’est pourquoi les quelques éléments d’une éthique de l’amour ne sont fournis que par le personnage le moins intéressé, à savoir Clélia. Si elle accepte de trahir la volonté du père, afin de sauver son amant, elle refuse, dans un premier temps, de hisser ce dernier à un rang supérieur à celui du père ou de la Madone. Aussi, impose-t-elle à Fabrice de ne plus la voir, sinon dans l’ombre. Mais, l’amour réaffirme ses droits sacrés et l’oblige à rompre son serment, pour empêcher Fabrice de trépasser par empoisonnement. Du côté de l’auteur, l’éthique de l’amour semble se résumer en peu de choses. Il est interdit aux Gilleti, même lorsqu’ils sont plus constants et fidèles, et réservé aux « HAPPY FEW ».
III.2. Endurance physique
Par ailleurs, le corolaire de cette action morale est le consentement aux pires épreuves physiques, pour prouver son amour ou pour se sacrifier en faveur de l’amant, sans aucun égard à la souffrance, telle que la conçoivent les communs des mortels. Phèdre utilise une expression homérique pour évoquer ce qu’Éros accorde aux amants : « la fougue qu’insuffle à certains héros la divinité. » Cet héroïsme à une forme précise: « mourir pour autrui.» Mais, cet acte n’est soutenable que par les amoureux, hommes ou femmes, ce qui est le signe d’un altruisme radical, qui surpasse tout autre lien. C’est le cas d’Alceste qui « fut la seule à consentir à mourir à la place de son époux, alors que celui-ci avait encore son père et sa mère. » Bien que Diotime refuse d’admettre que l’amour fonde un tel héroïsme, préférant l’hypothèse du désir de s’assurer « pour l’éternité une gloire impérissable », elle n’en demeure pas moins qu’elle dresse admirablement la liste de ceux qui sont « prêts à prendre tous les risques… à endurer toutes les peines. » : ‘’Alceste morte pour Admette’’ ; ‘’Achille [suit] Patrocle dans la mort’’ ; ‘’Codros…au-devant de la mort’’. Pour faire fléchir Hermia, Thésée lui promet l’enfer des épreuves : « Pourrez-vous endurer la robe monacale ? / Être à jamais recluse en un couvent obscur, / Vivre toute une vie comme nonne stérile. » Elle accepte l’ordalie, tout en agrémentant le menu par la mort, dans une réplique en crescendo, qui manifeste plutôt la joie de celle qui veut vider la coupe jusqu’à la lie : « Moi, je veux croître ainsi, vivre ainsi, puis mourir. » L’acte héroïque en signe et gage d’un amour indéniable est mis en abyme, dans le cadre du théâtre dans le théâtre, lorsque Pyrame, croyant que Thisbé était bouffée par le lion, il se suicide de dépit. Thisbé « revient ; lui prenant son poignard, elle se tue.» Le mode farcesque et lamentable de la scène montre cependant que l’esprit du sacrifice pour l’aimé relève parfois du ridicule. C’est parce qu’elle aime Fabrice que Gina accomplit le geste physique le plus éprouvant dans le roman, et qui s’apparente à une offrande au monstre, qui fait saigner non le corps seulement, mais l’âme. Les termes de l’accord avec le prince ressemble étrangement à un pacte avec le diable : « Jurez, madame, que si Fabrice vous est rendu sain et sauf, j’obtiendrai de vous, d’ici à trois mois, tout ce que mon amour peut désirer de plus heureux ; vous assurerez le bonheur de ma vie, en mettant à ma disposition une heure de la vôtre et vous serez toute à moi. ».
Conclusion
Articulé sur les œuvres considérées, le propos de Sigmund Freud, qui stipule que le sujet aimant est mal protégé contre la souffrance, nous a permis d’appréhender la question de l’amour dans ses aspects les plus contradictoires et complexes. D’abord, l’amour est perçu comme le lieu de la souffrance, occasionnant le sentiment aigu de manque, quand ce n’est pas l’agression provenant de l’extérieur qui assomme l’amoureux. Cependant, l’amour, au vu de ses propres ressorts, accorde à l’amoureux la possibilité de se libérer de la stagnation de la vie normale et, partant, de l’ennui ; et de s’affranchir de toutes les autorités. Enfin, parler de la souffrance, quand on aime, est presque une contre-vérité, puisque c’est l’amour justement qui impose un mode de vie, où la souffrance ne prend plus, puisqu’il est saisi par l’éthique et l’endurance. L’amour n’est-il pas une aubaine, pour celui qui considère, à la suite de Schopenhauer, que la vie entière ne cesse d’osciller entre ennui et souffrance ?
Citations à retenir
Le Banquet :
‘’Amour’’ est « fils d’Expédient et de Pauvreté ».
L’amoureux peut supporter d’être méprisé par « son père, ses amis ou quelqu’un d’autre, que par son amant. »
Amour « apporte la douceur, alors qu’il écarte l’agressivité... généreux en bienveillance, avare en malveillance.»
« C’est que chez les barbares, l’exercice du pouvoir tyrannique conduit à faire de cela, en tout cas, quelque chose de honteux. »
Songe d’une nuit d’été.
« Hélas ! pourquoi faut-il, dans tout ce que j’ai lu, ou ce que j’entendis de contes ou d’histoires, qu’un véritable amour n’ait jamais court facile ? »
« Ce sera ou bien d’épouser ce gentilhomme (Démétrius) / ou de mourir ainsi que le veut notre loi.»
« Prenons donc patience au sein de notre épreuve, / Puisqu’elle est pour l’amour entrave habituelle.»
La Chartreuse de Parme
« N’est pas chose plaisante (…) que je ne sois pas susceptible de cette préoccupation exclusive et passionnée qu’ils appellent de l’amour ? »
« N’est-il pas plaisant de voir que le bonheur m’attendait en prison ? ».
TO THE HAPPY FEW.
Passages clés
Dans Le Banque, il serait intéressant de repérer les six éloges de l’amour, le septième étant consacré à Socrate, par Alcibiade.
On lira avec profit les différents éloges, notamment celui assurée par Diotime.
Dans Songe d’une nuit d’été, la scène de querelle familiale entre Hermia et son père Égée est capitale, pour une meilleure intelligence de la pièce.
L’inconstance des amoureux, après avoir subi le suc d’Obéron, est décisive, puisqu’elle montre les complexités du comportement en amour. Au début : Hermia a